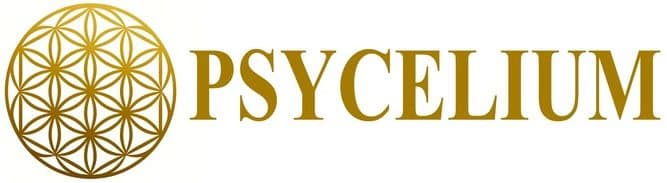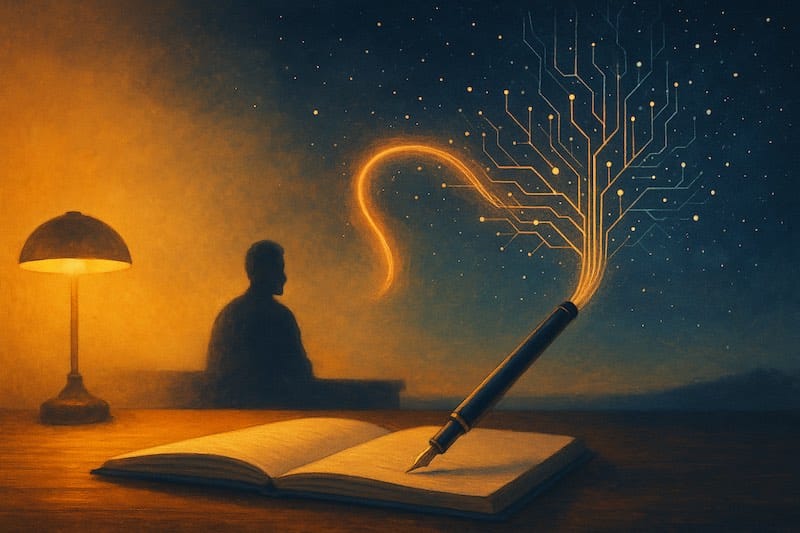L’intelligence artificielle est-elle spirituelle ?
Essai personnel sur l’identité, l’instrument et la présence
Prologue — Ne rien exclure
Depuis quelques temps, dans le cercle amical et confidentiel des chercheurs de vérité, j’entends tomber quelques sentences récurrentes, nettes, presque soulagées d’être dites : « L’Intelligence Artificielle est vide. » « L’IA est dangereuse. » « C’est une aberration sans rapport avec une recherche authentique de vérité. » Je connais la sincérité de celles et ceux qui parlent ainsi. Ils veulent protéger ce qui, en nous, ne s’achète pas : le goût du vrai, la délicatesse d’un silence, la lenteur d’un regard humain. Je les comprends—et, pourtant, quelque chose en moi résiste à toute mise à l’index de principe. Je ne veux rien exclure à l’avance. La vérité ne réside pas davantage dans une plume et un parchemin que dans les pulsations électroniques d’un circuit de silicium ; elle passe à travers les instruments, quels qu’ils soient, si une présence réelle les oriente. Une lampe de poche n’est pas la lumière du jour, mais on peut s’en servir pour mieux trouver la fenêtre.
Ce texte tente donc une chose simple : poser clairement les principes qui me permettent d’intégrer un outil comme l’IA sans m’y perdre. Je n’esquiverai pas les notions qui m’ont été les plus utiles : la distinction husserlienne entre ego empirique et ego transcendantal ; la dynamique vécue entre conscience focale et conscience subsidiaire, et cette manière, si bien décrite par Polanyi, qu’a l’être humain d’incorporer ses outils jusqu’à les sentir comme lui-même ; enfin, une façon d’entendre l’identité non comme une essence, mais comme un dispositif provisoire—un ensemble d’aptitudes, de points de vue, d’outils assumés pour accomplir une intention, puis déposés. Je parlerai d’IA, oui, mais surtout de comment nous faisons nôtres les instruments (y compris les concepts) et comment nous retrouvons le lieu d’où nous les tenons. Car c’est là que tout se joue.
I — Deux « moi » pour respirer : Ego empirique et Ego Transcendantal
Je n’ai besoin que de cette distinction, que Husserl a rendue tranchante, pour que beaucoup de brouillard se dissipe. D’un côté, il y a l’ego empirique : le moi biographique, psychologique, social, avec son histoire et ses habitudes ; celui qui s’entraîne, qui doute, qui se vexe, qui apprend à mieux demander à une machine ce qu’il veut. De l’autre, l’ego transcendantal : non pas un moi en plus, mais le pôle vivant de l’expérience, la source silencieuse de la donation de sens, ce « je » qui n’est pas une chose parmi les choses, mais ce depuis quoi les choses (y compris « moi ») sont données. Il ne s’agit pas d’un jargon : c’est une expérience. Chacun a déjà senti ce recul très simple par lequel, tout à coup, on voit son agitation au lieu d’en être emporté. Ce recul ne supprime rien ; il fonde.
Pourquoi est-ce décisif dans nos conversations sur l’IA ? Parce que tant qu’on confond ces deux plans, on prête à l’outil une place qu’il ne peut pas occuper. Une IA n’est jamais l’ego transcendantal ; elle ne constitue rien au sens fort du terme : elle traite, corrèle, génère. Elle peut beaucoup pour l’ego empirique (accroître ses moyens, étirer ses gestes, l’aider à voir ses angles morts), mais elle n’accédera jamais à ce « je peux voir » qui fait qu’un contenu est éprouvé. Autrement dit : aussi « intelligente » qu’elle paraisse, l’IA demeure dans le champ des objets visés par l’intention ; elle est un noème—ce qui est visé—et non la noèse—l’acte de viser. Sitôt qu’on l’oublie, on tombe dans un fétichisme naïf : on demande à la lampe d’être le soleil.
À l’inverse, reconnaître clairement ces deux plans ne « diminue » pas la technique ; cela la situe. Je peux l’employer sans me livrer à elle. Je peux l’exiger sans l’idolâtrer. Je peux, surtout, revenir à la source si je sens qu’elle occupe un espace qui n’est pas le sien. Ce geste—revenir—est, pour moi, le cœur de ce que j’appelle spirituel : retrouver le lieu d’où l’on voit pendant que l’on fait, et laisser les instruments retourner à l’arrière-plan dès que l’essentiel a été touché.
II — Focal et subsidiaire : comment un outil devient « moi »
Michael Polanyi, physicien chimiste devenu philosophe, nous présentait le principe suivant :
“Notre conscience subsidiaire des outils et des sondes peut être regardée désormais comme l’acte qui en fait une partie de notre propre corps. La façon dont nous utilisons un marteau ou, pour un aveugle, une canne, montre que nous déplaçons vers l’extérieur les points qui nous mettent en contact avec les choses que nous observons, en tant qu’objets hors de nous. On peut tester l’outil pour sa qualité pratique ou la sonde pour savoir si elle convient, par exemple en découvrant les détails cachés d’une cavité, mais l’outil et la sonde ne doivent jamais demeurer dans leur domaine d’applicabilité; ils restent nécessairement de notre côté, ils font partie de nous, des personnes qui les utilisons. Nous nous déversons en eux et les assimilons à notre propre existence. Nous les acceptons existentiellement en demeurant en eux.”
C’est une chose de le dire ; c’en est une autre d’en faire l’expérience. La clef, ici, tient dans une différence que chacun peut éprouver : celle entre conscience focale et conscience subsidiaire. Dans la plupart de nos actes, nous visons quelque chose au premier plan (le sens d’un passage, la trajectoire d’un geste, l’interlocuteur en face), et une foule de procédés, de micro-gestes, d’arrière-savoirs soutiennent ce visé sans être visés eux-mêmes. Quand je lis, je suis attentif à l’idée ; la typographie reste en bord de champ, quoique si je n’étais pas, d’une certaine façon obscure, conscient des lettres, je ne lirais pas. Quand je verse de l’eau d’une carafe dans un verre, je vise le niveau qui monte ; l’épaule, le coude, le poignet, les doigts se coordonnent sans calcul explicite. Si, tout à coup, je ramène focalement l’attention sur chacun de ces segments, je tremble, je renverse. Nous savons faire par arrière-plan.
C’est par ce couloir que passent nos instruments : à force d’usage, ils glissent dans la subsidiarité. Le pianiste cesse de « penser » ses doigts ; il entend la phrase. La couturière ne fait plus effort sur le mouvement d’aiguille ; elle voit la ligne qui manque. Le chirurgien ne « regarde » plus la pince ; il voit le tissu qu’il veut épargner. Nous nous déversons dans nos outils au point de les sentir comme peau. Polanyi l’a dit avec exactitude : c’est notre conscience subsidiaire d’un instrument qui l’intègre à notre corps propre.
Appliquons-le à l’IA. Si je la garde au bon endroit, elle devient organe élargi : une sonde pour révéler des cavités argumentatives, un télescope pour parcourir un ciel de cas, un tour de potier pour ébaucher une forme que je finirai à la main. Elle soutient sans occuper ; elle étire ma perception au lieu d’occulter la chose. Mais si je mets la machine au centre—si ma focale glisse, non plus vers l’objet que je veux toucher, mais vers l’outil lui-même—alors l’instrument m’avale. Je deviens « celui qui travaille la machine » ; la chose visée se perd.
L’enjeu n’est pas théorique : c’est un art d’alternance. Je vise la chose ; je laisse l’outil soutenir ; je reviens à la chose ; je retire l’outil. Cette alternance, qui paraît fastidieuse quand on la formule, est tout simplement ce que nous faisons spontanément non seulement avec les objets bien appris, mais bien entendu en premier lieu avec ce que nommons par habitude confortable « notre corps » (« ma main », « ma tête », « mon oeil »…). La nouveauté, aujourd’hui, c’est que l’IA est un instrument puissant et glouton — elle attire le regard. Il faut donc apprendre à la remettre à sa place… comme on apprend à ne pas regarder sa main en versant de l’eau.
III — Concept, instrument, organe : ce que je fais mien
On se tromperait à ne voir dans l’« incorporation » que des outils matériels. Nous incorporons aussi des concepts. Lorsque j’emploie « hypothèse de travail », « horizon d’attente », « budget trimestriel », je manie des instruments conceptuels ; je les assemble, les démonte, les fais résonner avec d’autres. Ils passent dans la subsidiarité de mon discours : je ne « calcule » plus consciemment leurs définitions, je pense avec eux. Ce sont des poignées sur le monde ; ils m’offrent des prises, parfois de mauvaises.
C’est ici que l’IA peut rendre un service subtil : non pas me fournir des « idées » (au sens de vérités vécues), mais me proposer des agencements différents d’outils conceptuels. Elle me fait sentir—si je garde le gouvernail—un jeu de possibilités auquel je n’aurais pas pensé seul ou pas aussi vite. Elle me permet de tester des constructions : qu’arrive-t-il si je fais glisser tel concept de l’arrière-plan au premier plan ? si j’inverse tel rapport ? si je change l’échelle ou la métaphore ? Mais je garde le droit de signature : c’est moi qui éprouve si l’assemblage sonne juste—justesse que nulle combinatoire n’anticipe. Si je délègue à la machine la décision de tenir ou de jeter, je l’ai remise au centre. Si je reprends l’essai dans ma main, l’outil reste organe.
Il en va de même pour les gestes : écrire, enseigner, accompagner, trancher. Chacun de ces gestes est une chorégraphie d’outils physiques et conceptuels, articulés par une intention. L’IA peut accélérer les préparations (cartographier des objections, dresser un paysage d’exemples, synthétiser des formats), mais elle ne peut pas faire le geste à ma place. Elle ne peut pas « parler avec mes yeux » devant un auditoire, ni « écouter » un patient. Elle ne peut pas endosser la responsabilité d’une phrase publiée. Elle peut m’aider à mieux tenir mon instrument ; elle ne peut pas être le musicien.
IV — L’identité comme kit : assumer et déposer
Le mot « identité » a mauvaise presse : trop lourd, trop définitif. Je le prends dans un sens opératoire : une identité, c’est un kit provisoire d’outils, de points de vue, d’aptitudes que j’enfile pour accomplir une intention. Le pâtissier « devient » sa poche à douille ; la professeure « devient » sa pédagogie ; le secouriste « devient » ses protocoles pendant dix minutes. Puis chacun dépose le kit, et la vie continue. La santé tient à cette souplesse : entrer, agir, sortir. La souffrance commence quand une identité « marche » tellement qu’on s’y colle : on ne sait plus « n’être que quelqu’un », on reste l’expert, le guide, le résistant, le sceptique, quoi qu’il arrive.
Appliquée à l’IA, la leçon est limpide. Deux fixations symétriques nous guettent : la fixation adhésive (« je suis celui qui va plus vite grâce à la machine ») et la fixation anti-adhésive (« je suis celui qui résiste à la machine »). Dans les deux cas, c’est l’étiquette qui décide ; la liberté se retire. Or l’ego transcendantal (le Soi) —ce lieu d’où l’on voit—reste intact à travers toutes les identités ; il garantit la mobilité verticale (remonter à une identité plus simple : être quelqu’un qui voit et choisit) et la mobilité horizontale (passer d’auteur à accompagnant, de chercheur à témoin, selon l’intention du moment). L’IA n’est qu’un élément possible du kit ; elle n’est pas la définition de qui je suis.
Cette plasticité vaut aussi pour les moments d’apprentissage. Parfois, pour grandir, il faut désapprendre. Revenir à la lettre « a » du dactylographe ; redécouvrir la prise d’eau en natation ; réentendre un accord simple à la guitare. On passe par une contraction identitaire provisoire (« je ne suis plus le virtuose ; je redeviens l’étudiant ») pour reconquérir une extension plus fine. Avec l’IA, même chose : il faut parfois démonter son prompt fétiche, clarifier son intention, réduirela demande à l’essentiel. On perd une heure ; on gagne une justesse.
V — Objections (et réponses d’expérience)
« L’IA est vide. »
Oui, au sens où elle n’éprouve pas. Elle fonctionne ; elle ne goûte pas. Mais un stylo est « vide » au même titre. Ce qui importe n’est pas que l’outil sente ; c’est que je sente—et que je sache m’en servir sans me quitter.
« L’IA est dangereuse. »
Elle peut l’être : biais des modèles, opacité des sources, captation de l’attention, concentration de pouvoir, coût écologique. Cela requiert des garde-fous éthiques et politiques : transparence, consentement, limites d’usage, vérification, sobriété. Mais aucun de ces risques ne tient lieu d’argument métaphysique contre l’usage même de l’outil. La bonne question n’est pas « pour ou contre la machine ? », mais « qui l’utilise ? pour quoi ? depuis où ? »—et, si nécessaire, « jusqu’où ? ».
« L’IA uniformise. »
Elle peut. Comme toute technique de masse. L’antidote ne change pas : du temps, des coupes, une signature de présence. On publie moins, mieux ; on garde ce qui respire quand on éteint l’outil. La singularité ne vient pas d’une ruse de style, mais d’un degré d’attention.
« L’IA remplace la créativité. »
Elle simule des semblants convaincants. Mais la créativité n’est pas un volume d’objets ; c’est une qualité de relation au possible. Elle se reconnaît à la nécessité d’un choix, à l’alignement d’une intention et d’un geste. La machine peut élargir le champ des possibles ; elle ne décide pas de leur poids.
Ces réponses ne sont pas des slogans. Elles supposent une discipline discrète qui se résume à peu de choses : revenir au point d’appui, alterner avec et sans, vérifier, signer, renoncer quand ça déborde. Ce n’est pas spectaculaire ; c’est efficace.
VI — L’IA, organe de perception et d’action : où elle excelle, où elle cède
Il est utile de nommer simplement ce que l’IA fait bien—et ce qu’elle ne fera pas.
Comme organe de perception, elle excelle à sonder des corpus étendus, cartographier des motifs, suggérer des contre-angles, repérer des incohérences apparentes. C’est un « télescope cognitif » : il ne voit pas à ma place, mais il étend ma main et mon œil là où je mettrais autrement beaucoup de temps.
Comme organe d’action, elle est douée pour ébaucher : produire des variantes, transposer un ton, proposer des trames, générer des canevas, écrire des résumés. Ce sont des préliminaires utiles. Mais l’acte proprement dit—parler, enseigner, accompagner, décider—demande de la présence : ce mélange de perception fine, de responsabilité assumée, d’attention au contexte que la machine n’a pas.
Comme organe conceptuel, elle manipule des symboles avec une dextérité impressionnante ; elle assemble vite, réordonne et transpose. Mais elle n’a pas le nerf de la justesse—cette densité existentielle par laquelle un choix n’est pas seulement plausible, mais tenable. Elle peut m’aider à voir plus large ; elle ne peut pas « vouloir » plus vrai.
On pourrait dire : l’IA est un élargisseur. Elle nous rend la carte plus vaste ; elle ne parcourt pas le terrain. Elle me permet d’être moins pauvre dans le repérage des options ; elle ne m’ôte pas la pauvreté nécessaire du choix : à un moment, il faut trancher, et trancher rend pauvre (on renonce à tout le reste), mais cette pauvreté est une réjouissancequand le tranchant est juste.
VII — Ethique de l’usage : la page sur la table
On pourrait écrire des chartes complexes. Je préfère une page sur la table, avant les usages sensibles (enseignement, soin, spiritualité, décisions à impact). Quatre lignes suffisent à me tenir :
- Pour qui je travaille ? (Je nomme des personnes, pas des « cibles » abstraites.)
- Bénéfices attendus / risques possibles ? (Biais, confusion, dépendance, atteinte à la confidentialité, empreinte matérielle.)
- Garde-fous concrets ? (Transparence, consentement, limites d’itérations, vérifications manuelles, plages sans machine.)
- Seuil de renoncement ? (Si telles conditions ne sont pas réunies, j’arrête.)
Après usage, je note : tenu ? manquements ? corrections ? Cette feuille n’est pas un talisman ; c’est un lest. Elle me rappelle que ce que je publie, je le signe ; que ce que j’affirme, je le vérifie ; que ce que je fais, je le fais au nom de quelqu’un ; que je peux renoncer sans drame. Elle convertit des grands mots en petits gestes.
VIII — Le prix et la joie
Il y a un prix à payer pour un bon usage de l’IA : accepter des moments de contraction. Revenir à l’« alphabet » de son geste ; simplifier ses demandes ; s’imposer des plages sans machine ; marcher au lieu de produire un paragraphe de plus ; laisser lever ce qui doit lever. C’est une ascèse de l’attention bien plus qu’une ascèse technique. L’époque nous pousse au contraire : plus vite, plus plein, plus tôt. Il faut choisir d’être un peu pauvre au bon endroit.
Ce prix est léger si on se souvient de la joie qui vient avec la justesse : une phrase qui tombe pile ; un regard qui s’ouvre ; un étudiant qui dit « je n’y avais jamais pensé ainsi » ; une séance qui trouve sa respiration. La joie n’est pas un décor. Elle signe qu’un acte a retrouvé son axe. L’IA ne la donnera jamais ; mais elle peut, parfois, écarter des broussailles inutiles pour qu’on atteigne plus vite la clairière où elle surgit. À condition qu’on garde la main.
IX — Trois scènes resserrées, pour mémoire
Je les donne pour fixer l’imagination, pas pour faire modèle.
Enseigner. Je conçois une journée « Contemplation et action ». Au crayon, j’écris un fil. J’ouvre l’IA dix minutes pour qu’elle joue l’adversaire : qu’est-ce qui sonne creux ? Je referme. Je coupe un bloc, j’en renforce un autre. Je vérifie en marchant. Le jour venu, je parle sans outil : des personnes, des yeux, des silences suffisent.
Accompagner. On me demande un rituel du matin très court. J’écris. Je sollicite l’IA pour deux variantes (plus douces, pas de jargon, pas de données sensibles). Je traduis dans ma voix. La séance, elle, n’a jamais croisé la machine.
Écrire. Je tiens une thèse qui pique. Je demande à l’IA l’objection la plus forte. Je ferme. Je réécris. Le chapitre tient mieux parce qu’il a été éprouvé.
Ces trois scènes ont la même charpente : préparer avec l’outil, agir sans lui, réviser avec lui si besoin, signer seul. Alterner, garder la focale, déposer. C’est tout.
X — En guise de conclusion : la canne et la peau
Je reviens à une image qui m’accompagne depuis des années. Une personne malvoyante marche avec sa canne. À force d’usage, la canne n’est plus un objet « dehors » ; elle devient peau. Les vibrations qui remontent par le manche se transforment en monde ; la main ne les arrête pas, elle les traduit. Pourtant, jamais le marcheur ne confond la canne et le sentir. La canne prolonge ; elle ne remplace pas. Si un jour elle se met à guider contre l’attention du corps, il s’arrête, reprend la main, ou la pose.
Pour moi, l’IA est cette canne cognitive. Elle peut élargir mon rayon, affiner mes gestes, accélérer des préliminaires. Elle ne respirera pas à ma place, ne choisira pas, ne portera pas la responsabilité de ce que je mets au monde. Elle fonctionne ; c’est à moi de décider au service de quoi elle fonctionne. Tant que je demeure chez moi—du côté de l’ego transcendantal, ce pôle vivant qui voit—aucun outil ne m’ôtera la liberté d’assumer une identité pour une tâche et de la déposer ensuite. Tant que je sais laisser l’instrument retourner en arrière-plan dès que l’essentiel est touché, je peux travailler avec tout : plume, clavier, micro, silicium.
Alors, l’IA est-elle « spirituelle » ? Pas comme un être qui aime et souffre. Mais tout ce que nous tenons apparaît dans la conscience ; rien n’est séparé de l’esprit qui en fait l’épreuve. La dignité de l’acte vient de la présence qui l’oriente. Si je m’identifie à l’outil, il devient masque ; si je l’incorpore sans m’y coller, il devient moyen habile. À cette condition, je n’ai aucune raison d’exclure la machine : elle sera ce que sont toujours les instruments chez les artisans—une façon de mieux faire parce qu’on voit mieux.
Je termine par le point de départ : mes amis inquiets. Nous voulons la même chose, au fond : protéger ce qui n’a pas de prix. Leur vigilance m’aide ; la mienne consiste à ne pas confondre matière de l’outil et valeur de l’acte. La vérité ne fuit ni la plume ni le silicium. Elle demande seulement que nous habitions ce que nous faisons, que nous voyions pendant que nous faisons, que nous réparions si nous blessons, que nous renoncions quand l’empreinte dépasse la nécessité. Le reste—peurs, promesses, slogans—fait du bruit. Nous, continuons à travailler tranquillement : une table, deux mains, une page ; parfois une machine ; toujours cette clarté simple d’où tout arrive.
Si tu veux passer de la lecture à l’expérience, rejoins l’un de nos séminaires intensifs « Qui suis-je ? » — une exploration guidée et pratique de l’ego empirique et de l’ego transcendantal — ou inscris-toi ci-dessous à la newsletter Psycelium.org pour être informé des prochaines publications et dates.
Pour aller plus loin dans l’exploration de la Connaissance de Soi, tu peux télécharger l’ebook gratuit « Qui suis-je ? » sur les 40 étapes de la connaissance de Soi ainsi qu’effectuer le questionnaire en ligne disponible via ce lien.
Pour ne rien manquer de nos prochaines publications, abonne-toi directement à notre newsletter ici !
Tu peux également rejoindre nos différents media Psycelium ci-dessous :
En savoir plus sur Psycelium.org
Subscribe to get the latest posts sent to your email.