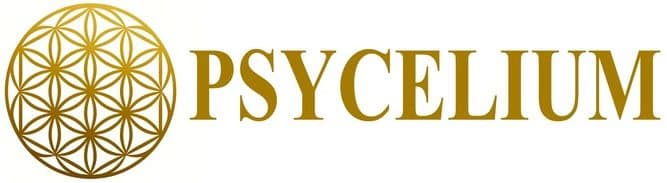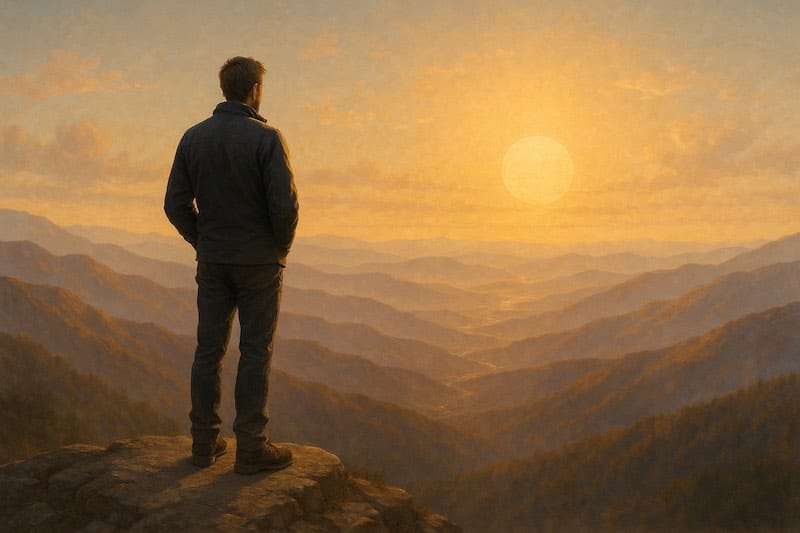Trouver le sens de sa vie : une nécessité existentielle, pas un luxe (Viktor Frankl)
« Pourquoi suis-je ici ? » « Quel est le sens de ma vie ? »
Ces questions résonnent différemment selon les personnes. Certaines les écartent d’un revers de main, les jugeant trop philosophiques ou narcissiques. D’autres les fuient, craignant de ne jamais trouver de réponse satisfaisante. D’autres encore les portent en silence, comme un fardeau invisible qui pèse sur leur quotidien.
Pourtant, pour de nombreux penseurs, philosophes et thérapeutes – et parmi eux Viktor Frankl, le fondateur de la logothérapie –, ces interrogations ne sont ni un caprice intellectuel ni un luxe réservé aux moments de crise. Elles constituent une exigence fondamentale de l’être humain, un besoin aussi essentiel que celui de manger ou de dormir.
Trouver le sens de sa vie n’est pas un luxe ou un caprice : c’est une nécessité psychique et existentielle. Le manque de sens se manifeste à travers de nombreux symptômes – ennui profond, anxiété chronique, dépression, addictions, sensation de vide, perte de repères – qui touchent de plus en plus de personnes dans nos sociétés modernes.
Cet article explore pourquoi certaines personnes n’ont pas accès au sens (ou ne parviennent pas à le percevoir), comment les explorations de Viktor Frankl offrent une voie de compréhension et de guérison, et quelles pistes concrètes peuvent nous aider à cheminer vers ce sens au quotidien, dans notre contexte contemporain.
1. Le défi contemporain du sens : vivre dans un monde désorienté
1.1 Un monde sans repères fixes
Dans les sociétés modernes occidentales les grandes sources collectives de sens se sont considérablement affaiblies ou fragmentées au cours du dernier siècle. La religion, la tradition, les hiérarchies sacrées, les structures communautaires qui offraient autrefois un cadre existentiel clair ont perdu de leur emprise sur les consciences.
Ce processus de désenchantement du monde, pour reprendre l’expression du sociologue Max Weber, représente à bien des égards un progrès : il a ouvert la voie à plus de liberté individuelle, à la remise en question des dogmes, à l’émancipation de nombreuses formes d’oppression. Mais cette libération a aussi laissé un “creux”, un vide existentiel que beaucoup peinent à combler.
Dans nos sociétés occidentales marquée par la laïcité, l’individualisme et le pluralisme des valeurs, chacun est désormais appelé à construire par lui-même son orientation, ses valeurs, son but dans la vie. Cette liberté est vertigineuse : elle exige de nous une créativité existentielle, une capacité d’auto-détermination que nous n’avons pas toujours appris à cultiver.
Sans accompagnement intérieur ou extérieur, beaucoup se perdent dans l’agitation perpétuelle, la consommation compulsive, la poursuite d’objectifs matériels, pensant qu’ils combleront ce vide. Mais ces palliatifs restent superficiels, comme tenter de remplir un puits sans fond avec des objets qui ne cessent de glisser au fond.
1.2 La saturation comme fuite du sens
Notre époque est marquée par une surinformation et une hyperconnexion sans précédent. Les écrans occupent une place centrale dans nos vies, nous bombardant constamment de stimuli, de notifications, de sollicitations. Cette saturation sensorielle et cognitive crée un bruit de fond permanent qui étouffe la voix intérieure.
Dans beaucoup de pays occidentaux, la culture de la performance et du rendement domine largement. Il faut être productif, efficace, optimisé en permanence. Le temps libre lui-même devient un temps à « rentabiliser » : développement personnel, sport intensif, loisirs planifiés avec précision.
Cette course perpétuelle laisse peu d’espace pour l’intériorité, pour le silence, pour ces moments de vacuité fertile où peut émerger la question du sens. L’agitation devient alors une forme de fuite, une manière inconsciente d’éviter la confrontation avec le vide existentiel.
1.3 Les symptômes d’une vie sans sens
Comment se manifeste concrètement ce manque de sens dans nos vies ? Voici quelques signaux d’alerte fréquents que tout thérapeute reconnaît :
- Une fatigue chronique qui n’est pas seulement physique : un épuisement de l’âme, une lassitude existentielle qui ne disparaît pas avec le repos
- Un ennui lancinant et profond : rien ne passionne vraiment, tout semble fade et sans saveur
- Une difficulté à se projeter dans l’avenir : l’horizon semble bouché, sans perspective réjouissante
- Des addictions diverses : aux écrans, aux drogues, à l’alcool, au sexe, au travail, à l’hyperactivité – toute forme de comportement compulsif visant à fuir le vide
- Le cynisme et la désillusion : le sentiment que « tout est vain », que rien n’a vraiment d’importance
- Une impression de déracinement : se sentir sans attache, sans appartenance, comme un étranger dans sa propre vie
- Une vie superficielle malgré les succès apparents : avoir une belle carrière, une situation confortable, mais se sentir vide à l’intérieur
Ces symptômes ne sont pas des faiblesses morales ni des signes de paresse ou d’ingratitude. Ils sont des signaux, des appels à l’aide que lance notre psyché. De la même façon que la douleur physique indique qu’il faut soigner un corps blessé, le mal-être existentiel indique qu’il faut réparer un lien rompu avec le sens.
2. Viktor Frankl et la logothérapie : une approche révolutionnaire du sens
2.1 Qui était Viktor Frankl ?
Viktor Emil Frankl (1905-1997) était un neurologue, psychiatre et philosophe autrichien qui a fondé la logothérapie, une approche thérapeutique existentielle centrée sur la quête de sens. Le terme « logothérapie » vient du grec logos, qui signifie « sens » ou « raison profonde ».
Son parcours personnel a profondément marqué sa pensée. Juif autrichien, Frankl a été déporté dans plusieurs camps de concentration nazis durant la Seconde Guerre mondiale, dont Auschwitz et Dachau. Il y a perdu sa femme, ses parents et la plupart des membres de sa famille.
Cette confrontation directe avec l’absurdité, la souffrance extrême et l’horreur l’a amené à se poser la question fondamentale : comment rester humain quand tout veut nous écraser ? Comment trouver une raison de vivre quand tout semble dénué de sens ?
C’est dans cette épreuve qu’il a élaboré et éprouvé sa conviction centrale : même dans les pires conditions, même face à une souffrance inévitable, la vie peut conserver un sens, et celui-ci constitue une raison suffisante pour continuer à vivre. Il a observé que ceux qui survivaient le mieux dans les camps n’étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, mais ceux qui avaient trouvé un sens à leur épreuve, qu’il s’agisse de retrouver un être cher, de témoigner de l’horreur vécue, ou simplement de préserver leur dignité humaine.
Après la guerre, Frankl a développé et systématisé la logothérapie, qui est aujourd’hui reconnue comme la troisième école viennoise de psychothérapie, après la psychanalyse de Freud et la psychologie individuelle d’Adler.
2.2 Les principes fondamentaux de la logothérapie
La logothérapie repose sur plusieurs idées-clés qui la distinguent radicalement des autres approches psychothérapeutiques :
La volonté de sens comme motivation primaire
Contrairement à Freud qui postulait que l’homme est principalement motivé par la recherche du plaisir (principe de plaisir), et à Adler qui mettait en avant la volonté de puissance, Frankl affirme que la motivation primaire de l’être humain est la volonté de sens. Nous ne cherchons pas d’abord à être heureux ou puissants, mais à trouver et à accomplir un sens dans notre existence.
Le sens est unique et situationnel
Pour Frankl, le sens n’est jamais abstrait, universel ou théorique. Il est toujours concret, unique à chaque personne, et spécifique à chaque situation. Il n’existe pas un « sens de la vie » valable pour tous, mais des sens particuliers à découvrir dans les circonstances singulières de notre existence.
Cette conception évite le piège du dogmatisme : le thérapeute n’impose pas un sens tout fait, mais accompagne la personne dans la révélation des valeurs qui l’appellent déjà, peut-être inconsciemment.
La liberté intérieure irréductible
Même dans les situations les plus contraignantes, même quand nous sommes privés de toute liberté extérieure, il nous reste toujours une liberté intérieure fondamentale : celle de choisir notre attitude face à ce qui nous arrive.
Cette liberté ultime ne peut nous être ôtée. Frankl l’a expérimenté dans les camps : on pouvait lui prendre ses biens, sa famille, sa dignité apparente, mais pas sa capacité à décider comment répondre intérieurement à cette situation.
La souffrance peut porter un sens
Contrairement à certaines approches qui cherchent à tout prix à éliminer la souffrance, la logothérapie reconnaît que certaines souffrances sont inévitables. Face à celles-ci, la question n’est pas de les supprimer, mais de leur trouver un sens, une signification qui les transfigure.
Cela ne veut pas dire glorifier la souffrance ou la rechercher, mais reconnaître que lorsqu’elle est incontournable, nous pouvons encore choisir la réponse que nous lui donnons, et cette réponse peut être porteuse de dignité, de croissance, de sens.
Le paradoxe du bonheur
Frankl identifie un paradoxe fondamental : chercher directement le bonheur conduit souvent à l’échec. Plus nous poursuivons le bonheur comme un but en soi, plus il nous échappe. En revanche, laisser le bonheur venir comme un « effet secondaire » d’une vie vécue de manière signifiante est bien plus réaliste et efficace.
Le bonheur ne se conquiert pas, il advient lorsque nous nous donnons à quelque chose qui nous dépasse.
2.3 Les trois grandes voies vers le sens
Dans sa réflexion, Frankl a identifié trois « portes » principales par lesquelles le sens peut se manifester dans notre vie. Ces trois voies ne s’excluent pas mutuellement ; au contraire, elles se complètent et peuvent toutes être présentes à différents degrés dans une existence équilibrée.
1. Les valeurs de création ou de contribution
Cette première voie concerne ce que nous apportons au monde par notre action, notre travail, notre créativité. Il s’agit de la dimension productive de notre existence : créer une œuvre d’art, accomplir un travail significatif, rendre un service, contribuer à une cause, éduquer des enfants, construire quelque chose qui nous dépasse.
Dans le contexte occidental contemporain, cette voie peut prendre de multiples formes : l’engagement associatif, le travail artisanal, la création d’entreprise à impact, l’enseignement, le soin aux autres, l’activisme écologique ou social…
2. Les valeurs d’expérience ou de réception
La deuxième voie concerne ce que nous recevons du monde. Ici, nous ne sommes plus acteurs mais récepteurs : contempler la beauté de la nature, écouter de la musique, aimer quelqu’un, se laisser toucher par une œuvre d’art, savourer un moment de grâce.
Cette dimension est souvent négligée dans nos sociétés productivistes qui valorisent avant tout l’action et le faire. Pourtant, savoir recevoir, accueillir, contempler est tout aussi essentiel pour une vie riche de sens. C’est dans ces moments où nous nous ouvrons au monde que nous pouvons toucher quelque chose d’infini.
3. Les valeurs d’attitude
La troisième voie est peut-être la plus profonde et la plus difficile : elle concerne notre attitude face à ce que nous ne pouvons pas changer. Face à la souffrance inévitable, à la maladie incurable, à la perte d’un être cher, à la vieillesse, à la mort, nous ne pouvons modifier la situation elle-même. Mais nous pouvons choisir comment nous y répondre.
Cette réponse peut être porteuse d’un sens immense : faire preuve de courage face à l’épreuve, maintenir sa dignité dans l’adversité, transformer sa souffrance en une source de compassion pour autrui, témoigner de son expérience pour aider d’autres personnes…
L’équilibre des trois voies
Ces trois chemins vers le sens ne se succèdent pas de manière linéaire, mais coexistent tout au long de notre vie. Selon les périodes, l’une peut dominer – par exemple, les valeurs de création dans notre vie professionnelle active, les valeurs d’expérience dans nos moments contemplatifs, les valeurs d’attitude face à une épreuve.
L’équilibre entre ces trois dimensions est souvent la marque d’une vie pleinement signifiante.
3. Pourquoi certaines personnes n’ont-elles pas accès au sens ?
Même en comprenant intellectuellement les concepts de Frankl, on peut se demander : pourquoi, malgré ces connaissances, certaines personnes restent-elles « bloquées » dans le vide existentiel ? Pourquoi le sens reste-t-il inaccessible pour beaucoup ?
Il n’existe pas une seule réponse, mais un faisceau de raisons qui peuvent s’entremêler. Nous pouvons les organiser selon trois niveaux interconnectés : existentiel (le contexte culturel), psychologique (les mécanismes intérieurs), et spirituel (la dimension relationnelle profonde).
3.1 Niveau existentiel : un contexte culturel qui étouffe
La désorientation culturelle généralisée
Dans notre société de consommation occidentale, axée sur l’accumulation matérielle, la performance individuelle et la satisfaction immédiate, il est extrêmement difficile d’orienter son cœur vers le long terme, le symbolique, l’intangible.
Les messages culturels dominants nous disent que le bonheur se trouve dans la possession, la réussite visible, le paraître. Ces valeurs ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais elles ne peuvent constituer les fondements d’une vie signifiante. Elles créent une forme de « bruit existentiel » qui couvre les appels plus subtils du sens.
L’absence de repères collectifs partagés
Les sociétés traditionnelles offraient des récits partagés, des mythes fondateurs, des rites de passage qui donnaient un cadre de sens collectif. Dans notre société laïque et plurielle, ces repères ont largement disparu sans être vraiment remplacés.
Beaucoup de personnes n’ont pas hérité d’une « grande histoire », d’un récit porteur qui les dépasse et les relie à une lignée, à une tradition, à un projet collectif. Cette absence de transmission symbolique laisse l’individu seul face à la construction de son sens.
La pression du rendement et de la productivité
Le monde du travail, même en France malgré ses protections sociales, reste largement dominé par une logique de productivité et d’efficacité maximale. Le temps est devenu une ressource rare à optimiser. L’occupation permanente, le remplissage de l’agenda, la multiplication des tâches laissent très peu d’espace pour l’intériorité, pour le recul, pour le questionnement existentiel.
Comment entendre l’appel du sens quand on court sans cesse d’une urgence à l’autre ?
La saturation médiatique et numérique
Dans un flux constant d’informations, d’images, de distractions, de sollicitations numériques, l’âme a du mal à respirer. Les réseaux sociaux créent une forme de « pseudo-connexion » qui peut même renforcer l’isolement et la perte de sens en nous enfermant dans une bulle narcissique.
Le silence, la solitude fertile, la contemplation – toutes ces conditions nécessaires à l’émergence du sens – deviennent de plus en plus rares et difficiles à cultiver.
3.2 Niveau psychologique : les blocages intérieurs
Le repli émotionnel et traumatique
Des blessures psychologiques non résolues – traumatismes d’enfance, deuils non faits, expériences de rejet ou d’abandon – peuvent inciter l’individu à se protéger par la dissociation, l’évitement émotionnel, l’insensibilisation.
Pour ne plus souffrir, certaines personnes se coupent de leur ressenti profond. Mais en s’anesthésiant émotionnellement, elles perdent aussi l’accès aux signaux intérieurs qui pourraient les orienter vers le sens. Le cœur fermé ne peut entendre l’appel.
La confusion mentale et les attentes irréalistes
Beaucoup de personnes attendent du sens une révélation spectaculaire, une illumination soudaine, un but grandiose qui s’imposerait avec évidence. Cette attente elle-même est un obstacle : le sens se manifeste souvent dans les petits signes, les intuitions discrètes, les mouvements subtils de l’âme.
Ne pas reconnaître le sens dans sa modestie quotidienne conduit à une attente stérile et frustrante.
Le conditionnement social et les injonctions
Dès l’enfance, nous intériorisons des messages sur ce qu’il faut être pour être accepté, aimé, reconnu : « réussir », « se conformer », « plaire », « être fort », « ne pas déranger »… Ces injonctions peuvent étouffer complètement l’appel intérieur authentique.
On finit par vivre pour répondre aux attentes extérieures – celles des parents, de la société, du milieu professionnel – au lieu d’écouter sa propre voix. Le sens personnel devient alors inaudible sous le vacarme des « il faut que ».
Le scepticisme et l’athéisme pratique
Pour certaines personnes élevées dans un contexte rationaliste strict, sans ouverture à une dimension spirituelle ou symbolique, parler de « sens » peut sembler creux, suspect, voire naïf.
Ce scepticisme de principe, s’il peut protéger contre certaines illusions, peut aussi fermer la porte à une dimension essentielle de l’existence humaine. Le sens ne se prouve pas comme un théorème mathématique ; il se découvre dans l’expérience vécue.
3.3 Niveau spirituel : l’oubli du « Tu »
Frankl insiste sur un point crucial : la dimension spirituelle de l’homme n’est pas nécessairement religieuse, mais elle est fondamentalement relationnelle. Le sens ne peut naître d’un « Je » replié sur lui-même, plein de ses désirs et de ses interrogations. Il naît de la rencontre, de l’ouverture à un « Tu » – un autre personne, une œuvre, une cause, une transcendance.
L’enfermement dans l’ego
Quand une personne reste enfermée dans son ego, dans l’auto-interrogation perpétuelle, dans une introspection stérile qui tourne en rond, elle ne peut accéder au sens. Le regard devient circulaire : on se regarde se regarder, on s’analyse sans fin, on cherche le sens « en soi », comme s’il s’agissait d’un objet caché quelque part dans notre psyché.
Mais le sens n’est pas « en nous » comme un trésor enfoui. Il est dans la relation, dans le lien à ce qui nous dépasse. C’est le sens même de ce site Psycelium, accompagner chacun vers une plus grande connexion à Soi mais également à l’Autre, tant les deux mouvements sont consubstantiels et indiscernables.
L’absence d’ouverture à l’altérité
Vivre uniquement « pour soi » – pour sa satisfaction, son plaisir, son confort, son développement personnel compris de manière narcissique – ne peut conduire au sens. Le sens émerge quand nous vivons « en réponse à » : en réponse à l’appel d’un être aimé, d’une mission qui nous sollicite, d’une beauté qui nous touche, d’une souffrance qui demande notre compassion.
Le regard de l’autre, la gratitude envers ce qui est reçu, l’ouverture au mystère de l’existence sont souvent les portes d’entrée vers le sens.
3.4 L’interdépendance des trois niveaux
Ces trois niveaux – existentiel, psychologique, spirituel – ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils s’influencent mutuellement dans un système complexe :
- Ce qui se passe au niveau culturel (saturation, consumérisme) conditionne notre « espace intérieur » et rend plus difficile le recueillement nécessaire à l’écoute du sens.
- Ce que nous portons psychologiquement (blessures, conditionnements) détermine la façon dont nous recevons ou interprétons les messages du contexte et nos capacités d’ouverture spirituelle.
- Notre degré d’ouverture spirituelle influence notre capacité à résister aux pressions culturelles et à guérir nos blessures psychologiques.
Une personne peut être plongée dans une culture extrêmement déshumanisante tout en possédant une grande qualité intérieure de présence – et inversement. Le chemin vers le sens demande souvent un rééquilibrage progressif de ces trois dimensions.
4. Retrouver l’accès au sens : pistes concrètes selon la logothérapie
La logothérapie n’est pas une doctrine figée ni une méthode mécanique. C’est une orientation intérieure, une attitude existentielle qui peut se cultiver à travers des pratiques concrètes. Voici des pistes opérationnelles que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne.
4.1 Redéfinir radicalement la question du sens
La première étape, fondamentale, consiste à inverser complètement notre question habituelle.
Ne demandez plus : « Quel est le sens de ma vie ? »
Cette formulation place le sens comme un objet à découvrir, une réponse préexistante qu’il faudrait trouver quelque part. Elle nous met en position passive, d’attente, de recherche parfois désespérée.
Demandez plutôt : « Quelle est la demande que la vie m’adresse ici et maintenant ? »
Cette reformulation change tout. Elle nous place en position de responsabilité active. Ce n’est plus nous qui interrogeons la vie, c’est la vie qui nous interroge. À chaque instant, dans chaque situation, il y a une demande, un appel, une possibilité d’action ou d’attitude qui attend notre réponse.
Le sens n’est pas ailleurs, dans un futur hypothétique ou dans une révélation grandiose. Il est ici, dans les petites choses concrètes de notre quotidien, dans la tâche qui attend, dans la relation qui s’offre, dans le défi qui se présente.
4.2 Exercice introspectif : trois séries de questions
Pour s’entraîner à percevoir les appels du sens dans les trois dimensions franckliennes, vous pouvez pratiquer régulièrement cet exercice de questionnement. L’idéal est de le faire chaque jour, le matin pour orienter la journée, ou le soir pour intégrer ce qui a été vécu.
Ces pratiques peuvent également être effectuées en dyades, si vous êtes déjà familier de la technique ou si vous avez déjà l’expérience d’un séminaire intensif « Qui suis-je ? ».
Questions sur les valeurs de création / contribution
- Quelle action, même modeste, pourrais-je accomplir aujourd’hui qui me dépasse un peu, qui contribue à quelque chose de plus grand que moi ?
- Qu’est-ce que j’ai toujours rêvé de faire, de créer, d’entreprendre, sans jamais oser franchir le pas ?
- En quoi mes talents, mes compétences, mes ressources pourraient-ils être utiles à autrui, à ma communauté, au monde ?
- Quel petit service puis-je rendre aujourd’hui, même invisible, même non reconnu ?
Questions sur les valeurs d’expérience / réception
- Quand ai-je ressenti dernièrement une émotion profonde, une beauté saisissante, une rencontre qui m’a vraiment ouvert le cœur ?
- Que puis-je recevoir aujourd’hui – de la nature, de l’art, de la musique, du silence, d’une relation – sans avoir besoin de « faire » quoi que ce soit ?
- Comment puis-je cultiver la gratitude dans les moments ordinaires de ma vie ?
- Qu’est-ce qui me touche, m’émeut, me bouleverse – et pourquoi est-ce important ?
Questions sur les valeurs d’attitude
- Qu’est-ce que je traverse en ce moment que je ne peux absolument pas changer ?
- Quelle attitude digne, courageuse, humaine puis-je adopter malgré cette difficulté ?
- Comment puis-je accepter, transformer ou donner un sens à ma souffrance actuelle ?
- Quel témoignage, quel exemple puis-je offrir à travers ma façon de faire face à l’épreuve ?
Faire ce travail régulièrement, même cinq minutes par jour, aide à entraîner ce que l’on pourrait appeler le « muscle de l’orientation ». Progressivement, la perception du sens s’affine, s’aiguise, devient plus naturelle.
4.3 Cultiver la présence : méditation existentielle
La pratique de la présence consciente, que l’on peut appeler « méditation existentielle », ne vise pas le détachement ou l’évacuation des pensées comme dans certaines formes de méditation bouddhiste. Il s’agit plutôt d’une ouverture attentive à ce qui est : ce jour précis, cette relation particulière, cette émotion présente, cette tâche concrète.
Concrètement, cela peut prendre plusieurs formes :
- Des moments de silence quotidien : quelques minutes chaque jour sans écran, sans stimulation, pour simplement être présent à soi-même et au monde.
- Une marche contemplative : se promener en nature ou même en ville en prêtant attention aux sensations, aux couleurs, aux sons, sans objectif de performance.
- L’attention aux gestes simples : manger, boire, respirer en conscience, en savourant pleinement l’expérience.
- L’écoute profonde : dans une conversation, être vraiment présent à l’autre, sans préparer sa réponse, sans juger.
En ralentissant le rythme mental frénétique, nous donnons à l’âme la possibilité de se manifester, aux intuitions de sens de remonter à la surface.
4.4 Créer un « horizon de sens »
Même si le sens est toujours situationnel et concret, il peut être aidant de se donner certaines grandes directions qui orientent notre vie sur le moyen et long terme. Ces horizons ne sont pas des objectifs rigides, mais des étoiles qui guident notre navigation.
Cela peut prendre la forme de :
- Une cause à laquelle se consacrer : l’écologie, la justice sociale, l’éducation, l’aide aux personnes vulnérables, la préservation de la culture…
- Un projet créatif ou artistique : écrire un livre, développer une pratique musicale, créer une œuvre qui laissera une trace.
- Un engagement communautaire : s’investir dans une association, un collectif local, un projet de quartier ou de village.
- Un idéal humain à incarner : cultiver la compassion, chercher la vérité, créer de la beauté, œuvrer pour la paix intérieure et extérieure.
- Une mission familiale ou éducative : élever des enfants avec conscience, transmettre des valeurs, accompagner des proches dans leur développement.
Cet horizon n’est pas fixe une fois pour toutes. Il peut se réviser, s’affiner, se transformer au fil de la vie. Mais il offre une boussole, une orientation générale qui aide à discerner quelles actions, quelles relations, quels engagements ont du sens.
4.5 Agir malgré la peur : l’initiative comme révélateur de sens
Un piège fréquent consiste à attendre de « sentir » le sens avant de se mettre en mouvement. On se dit : « Quand j’aurai trouvé ma voie, alors j’agirai. » Mais Frankl renverse complètement cet ordre :
C’est en agissant que le sens se révèle, pas l’inverse.
Nous n’avons pas besoin d’une certitude absolue avant de commencer. Nous pouvons faire un pas, même petit, même incertain, dans une direction qui nous attire ou nous interpelle. C’est dans ce mouvement, dans cette initiative concrète, que le sens commence à se manifester, à se clarifier, à se confirmer – ou à se rectifier.
Quelques principes pour cette démarche :
- Commencer petit : pas besoin de tout bouleverser d’un coup. Un geste modeste mais authentique vaut mieux qu’un grand projet qui reste à l’état de rêve.
- Accepter l’incertitude : on ne saura jamais à l’avance si c’est « le bon choix ». Il faut oser l’expérimentation, le tâtonnement.
- Écouter le retour d’expérience : après avoir agi, observer ce que cela produit en soi. Y a-t-il un sentiment de justesse, d’alignement ? Ou au contraire un malaise qui indique qu’il faut ajuster ?
- Persévérer avec souplesse : maintenir l’effort dans la durée tout en restant ouvert aux ajustements nécessaires.
4.6 Se faire accompagner : l’importance du regard extérieur
Le chemin vers le sens n’est pas un parcours solitaire. Nous avons besoin du regard, de l’écoute, de la présence d’autres personnes pour nous aider à clarifier, à encourager, à maintenir le cap.
Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes :
- Un psychothérapeute formé à la logothérapie ou à d’autres approches existentielles qui peut aider à identifier les blocages et à révéler les appels intérieurs.
- Un mentor ou guide spirituel (au sens large, pas nécessairement religieux) qui a parcouru un chemin similaire et peut partager son expérience.
- Un groupe de pairs : des amis, un cercle de réflexion, une communauté de pratique où l’on peut échanger, partager, s’encourager mutuellement.
- Un coach existentiel qui aide à définir et poursuivre des projets alignés avec les valeurs profondes.
Dans tous les cas, la qualité de la relation est plus importante que la méthode ou la technique. Ce qui aide vraiment, c’est une présence authentique, une écoute profonde, un regard qui nous reconnaît dans notre aspiration au sens.
5. Témoignages et exemples concrets : le sens au quotidien
Pour rendre ces réflexions plus tangibles, voici quelques exemples de parcours vers le sens. Ces histoires, inspirées de situations réelles (avec des prénoms modifiés pour préserver l’anonymat), illustrent comment le sens peut se révéler dans des contextes très différents.
Marie : retrouver le souffle par l’écriture
Marie, 42 ans, occupait depuis quinze ans un poste de cadre supérieur dans une grande entreprise parisienne. Salaire confortable, sécurité, reconnaissance professionnelle : de l’extérieur, sa vie semblait réussie. Pourtant, elle se sentait de plus en plus vide, épuisée, comme si elle jouait un rôle dans une pièce qui ne lui correspondait plus.
Après une période de questionnement et quelques séances de thérapie, Marie a identifié un appel ancien, enfoui : l’écriture. Adolescente, elle remplissait des carnets, écrivait des nouvelles. Mais elle avait abandonné tout cela pour des études « sérieuses » et une carrière « raisonnable ».
Elle a commencé modestement : tenir à nouveau un journal intime, puis rejoindre un atelier d’écriture hebdomadaire. Progressivement, elle a découvert qu’elle pouvait mettre ses compétences professionnelles au service d’associations : rédiger des rapports, des demandes de subventions, communiquer sur des causes sociales.
Le sens n’est pas venu d’un grand chamboulement, mais de petits pas : quelques heures d’écriture par semaine, puis du bénévolat rédactionnel. Aujourd’hui, Marie envisage sereinement une reconversion progressive vers la communication associative. Elle a retrouvé un souffle, une direction.
Antoine : la maladie comme source de relation
Antoine, 55 ans, a été diagnostiqué avec une maladie chronique invalidante il y a cinq ans. Les premiers temps ont été terribles : révolte, déni, dépression. Il avait l’impression que sa vie était finie, que tout ce qu’il avait construit n’avait plus de sens puisqu’il ne pouvait plus être « productif » comme avant.
Accompagné par un thérapeute, Antoine a progressivement exploré les « valeurs d’attitude » : comment pouvait-il répondre à cette épreuve de manière signifiante ?
Il a découvert qu’en acceptant sa vulnérabilité, en parlant ouvertement de sa maladie, il créait un espace où d’autres personnes osaient enfin exprimer leurs propres souffrances. Sa fragilité assumée est devenue une forme d’offrande, une invitation à l’authenticité.
Antoine a rejoint un groupe de parole pour personnes atteintes de maladies chroniques, puis est devenu animateur bénévole. Il témoigne dans des conférences, écrit sur son blog. Sa souffrance, qu’il ne peut supprimer, est devenue une source de relation, de compassion, de service.
Léa : la crise de la quarantaine comme renaissance
Léa approchait de ses 40 ans quand elle a été saisie par une angoisse existentielle profonde. Mère de deux enfants, mariée, enseignante dans un collège de province, elle avait l’impression que sa vie était « déjà écrite », prévisible, sans surprise ni élan.
Elle s’est posé la question radicale : « Si je savais qu’il me reste seulement dix ans à vivre, est-ce que je continuerais exactement cette vie ? » La réponse était non.
Avec le soutien de son mari et après beaucoup de réflexion, Léa a entrepris plusieurs changements : reprendre des études en psychologie (son ancienne passion jamais aboutie), s’engager comme bénévole dans un centre d’accueil pour migrants, et créer un petit atelier d’art-thérapie pour adolescents en difficulté.
Aucun de ces projets ne « rapporte » matériellement. Mais ils ont redonné à Léa un sentiment de vivacité, d’utilité, de contribution. La crise de la quarantaine, au lieu d’être une fin, est devenue une porte d’entrée vers une seconde partie de vie plus alignée avec ses valeurs profondes.
6. Conclusion : le sens comme chemin vivant
Trouver le sens de sa vie n’est pas un exploit héroïque réservé à quelques élus, ni une révélation mystique accessible seulement aux âmes spirituelles. C’est une quête humble, quotidienne, à la portée de chacun – mais qui demande du courage, de la patience et de l’honnêteté envers soi-même.
Le sens n’est pas une destination qu’on atteindrait un jour pour ensuite se reposer. C’est un chemin toujours en mouvement, une orientation qui se réajuste continuellement en fonction des circonstances de la vie, de nos transformations intérieures, des appels qui se présentent.
Certains jours, le sens sera évident, presque palpable. D’autres jours, il semblera s’éclipser, nous laissant dans l’incertitude. C’est normal. La vie est faite de hauts et de bas, de clarté et d’obscurité. Ce qui compte, c’est de maintenir l’écoute, de rester ouvert aux signes, de continuer à répondre du mieux possible aux demandes qui se présentent.
Dans notre contexte occidental contemporain, marqué par l’individualisme, le consumérisme, la saturation numérique et la perte des repères traditionnels, retrouver le fil du sens demande une forme de résistance créative. Il s’agit de créer des espaces de silence dans le bruit, des temps de présence dans l’agitation, des liens authentiques dans la superficialité ambiante.
La logothérapie de Viktor Frankl nous offre des outils précieux pour cette quête : redéfinir notre question, explorer les trois voies du sens (création, expérience, attitude), reconnaître notre liberté ultime, agir malgré l’incertitude.
Mais au-delà des techniques, ce qui compte vraiment, c’est l’attitude fondamentale : passer d’une position où nous interrogeons la vie à une position où nous acceptons d’être interrogés par elle. Chaque jour nous appelle à répondre – par un mot, un geste, une présence, un choix, une attitude.
Une invitation à poursuivre le chemin
Si cet article vous a touché, interpellé ou éclairé, je vous invite à ne pas en rester à la lecture passive. Le sens ne se trouve pas dans les livres ou les articles, mais dans l’expérimentation vivante.
Quelques pistes pour continuer :
- Pratiquez les exercices proposés : les trois séries de questions, les moments de présence, les petites initiatives.
- Partagez votre propre chemin : dans les commentaires de ce blog, avec vos proches, dans un journal personnel. Mettre des mots sur notre quête aide à la clarifier.
- Explorez d’autres ressources : lisez Frankl (notamment « Découvrir un sens à sa vie »), consultez d’autres articles de Psycelium sur la psychologie existentielle, la spiritualité laïque, le développement intérieur.
- Cherchez de l’accompagnement si nécessaire : un thérapeute, un groupe de réflexion, une communauté de pratique. Le chemin se fait rarement seul.
Le sens n’est jamais totalement découvert, totalement possédé. Il se révèle peu à peu, par fragments, dans le pas que nous posons en réponse à ce que la vie nous demande. Et c’est précisément cette recherche permanente, cet ajustement continu, cette réponse toujours renouvelée qui constitue l’aventure même d’une vie pleinement humaine.
Ressources pour approfondir
Ouvrages de Viktor Frankl (disponibles en français) :
- Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie (Man’s Search for Meaning) – L’œuvre majeure, accessible et bouleversante
- La Psychothérapie et son image de l’homme – Pour approfondir les bases théoriques
- Le Dieu inconscient – Sur la dimension spirituelle de l’existence
Autres lectures recommandées :
- L’Homme en quête de sens d’Elisabeth Lukas (disciple de Frankl)
- Vivre de Mihaly Csikszentmihalyi (sur le flow et l’expérience optimale)
- L’Âme du monde de Frédéric Lenoir (philosophie du sens)
Pour consulter :
Si vous ressentez un vide existentiel profond ou une souffrance psychologique, n’hésitez pas à consulter un professionnel de santé mentale. La recherche de sens peut parfois révéler des blessures qui nécessitent un accompagnement thérapeutique approprié.
Pour aller plus loin dans l’exploration de la Connaissance de Soi, tu peux télécharger l’ebook gratuit « Qui suis-je ? » sur les 40 étapes de la connaissance de Soi ainsi qu’effectuer le questionnaire en ligne disponible via ce lien.
Pour ne rien manquer de nos prochaines publications, abonne-toi directement à notre newsletter ici !
Tu peux également rejoindre nos différents media Psycelium ci-dessous :
Mots-clés : sens de la vie, trouver un sens, logothérapie, Viktor Frankl, vide existentiel, crise de sens, valeurs de vie, thérapie existentielle, quête de sens, spiritualité laïque, développement personnel profond, psychologie humaniste
En savoir plus sur Psycelium.org
Subscribe to get the latest posts sent to your email.